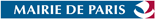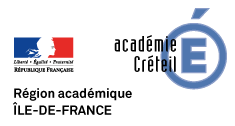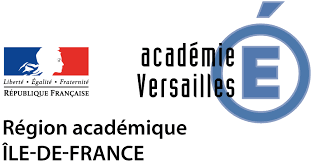Les écrivains / adhérents
Carole Zalberg
Roman / Jeunesse
Grand Prix SGDL du Livre Jeunesse 2008
Le Jour où Lania est partie, Nathan Poche
Carole Zalberg vit à Paris. Auteur, traductrice et parolière, elle a publié des romans et un livre pour la jeunesse. Elle a également participé aux recueils collectifs : Aime-moi, paru chez Nicolas Philippe en 2002, De B à Z, publié par le GREC en 2007, et à l’ouvrage Le geste et la parole des métiers d’art, paru au Cherche-Midi en 2004. Certains de ses poèmes figurent dans l’anthologie Les jeunes poètes français et francophones, parue chez Jean-Pierre Huguet éditeur en 2004. D’autres ont été retenus pour une anthologie de la poésie française publiée par Jean Orizet au cherche midi en 2004. Elle écrit par ailleurs des chansons pour divers artistes, et a rédigé des chroniques pour le magazine culturel www.avoir-alire.com/. Carole Zalberg a créé un site (www.carolezalberg.com) où l'on peut lire ses propres textes mais aussi découvrir les œuvres en mots ou en images de ses nombreux invités.
Bibliographie
Publications
– Léa et les voix, Nicolas Philippe/l’Embarcadère, 2002
– Les Mémoires d’un arbre, Le Cherche-Midi, 2002
– Chez eux, Phébus, 2004
– Mort et vie de Lili Riviera, Phébus, 2005
– La Mère horizontale, Albin Michel, 2008
– Le Jour où Lania est partie, Nathan Poche, 2008 (Grand Prix SGDL du livre pour la jeunesse)
– Et qu'on m'emporte, Albin Michel, 2009
– J'aime pas dire bonjour, Grasset-Jeunesse (illustrations : Boll), 2010
– L'invention du désir, Chemin de Fer, 2010
– A défaut d'Amérique, Actes Sud, 2011
– Feu pour feu, Actes Sud, 2014 (Prix Littérature Monde)
Extraits
J’aurais adoré que Tom se tienne à l’écart du sexe. Mon ange à jamais. J’ai tout fait pour. Le pauvre n’en finit pas de se dépatouiller avec le flou dans lequel je l’ai maintenu jusqu’à son départ de la maison… Aujourd’hui, peut-être parce que la question ne se pose plus, je peux repenser aux choses du corps sans nausée. Parfois même je m’offre une gourmandise : je revis en pensées mes meilleurs ébats ; un peu comme on retournerait dans un musée mille fois visité : avec un bonheur virant assez vite à l’ennui.
J’étais très jeune la première fois que j’ai couché. Dans les treize ans, pas plus. On était encore dans l’euphorie de l’après-guerre et sous le vernis de bienséance, on était nombreux à ne rien s’interdire. Il y aurait longtemps urgence à profiter, pour nous qui avions grandi talonnés par le danger, l’humiliation, la fin à tout instant possible. Notre enfance marquée comme du bétail par cette saloperie d’étoile, il avait fallu la vivre à l’arrachée. Alors ensuite, tout a été bon à prendre. Ah ! le retour des vraies pâtisseries, du vrai pain, de tout, peu à peu, sur la table et dans les magasins. Le rouge baiser, mis en cachette, d’un seul trait, dans l’escalier. Qui donnait envie d’avoir un flirt pour vérifier qu’on ne se barbouillerait pas en s’embrassant. Le simple plaisir de se promener dans les rues, après les cours et que rien ne pèse ni ne presse. La musique américaine, ce jaillissement de joie. Les soirées de liberté organisées sur des mensonges ou en faisant le mur, étirées ensuite jusqu’à l’aube parce qu’on le pouvait, parce qu’aucun couvre-feu n’obligeait plus à rentrer chez soi. On aurait bien le temps de dormir ; plus tard ; quand on serait un peu rassasié des bonheurs de la paix.
Pour la génération de nos parents, toutefois, c’était différent. Les miens, au lendemain de la guerre, étaient sonnés, tout rabougris. Ils ressassaient leur confiance trahie, leur loyauté bafouée, l’irruption tardive dans notre petit noyau familial d’une mort d’autant plus insupportable qu’elle avait été sans gloire.
Ils étaient arrivés en France des décennies plus tôt, y avaient été heureux, tranquilles. Tellement fiers d’appartenir – croyaient-ils - à ce nouveau pays où ils se figuraient être à l’abri. Ils avaient baissé la garde mes parents, leurs voisins du quartier Beaubourg, la famille en province. Tous, ils avaient forcé les anciennes peurs à ne plus les dominer. Comment se remettre d’une telle désillusion ? Que faire après qu’on a compté ses plaies, tous les trous obscènes dans ses rangs tels des dents manquantes ? J’ai vu Adèle et Louis, tes grands-parents, rouvrir grand la porte à la peur omniprésente, cette tyrannie. Je les ai vus, physiquement, l’accueillir. C’était dans leurs regards, méfiants, désormais, jaugeant quiconque les approchait. C’était dans les histoires qu’ils racontaient, toujours les mêmes, années après années, de perte, de chagrin, de destruction. Des histoires aussi poisseuses que le sang de leurs disparus. C’était dans leurs constantes mises en garde, comme si respirer était en soi un danger.
Je ne voulais entendre ni leurs souvenirs de grands brûlés ni leurs prophéties, et encore moins me heurter à leur silence concernant l’ultime et inacceptable disparition. Je ne voulais pas désespérer déjà. Moi je commençais tout juste à vivre. On se disputait sans cesse. Ou alors c’était le mutisme et l’asphyxie. J’allais respirer dehors, là où moi et tant d’autres, on s’étourdissait. J’oubliais en dansant, en me laissant embrasser, caresser et plus tard prendre à l’arrière des voitures ou dans les recoins sombres, ma famille meurtrie, mes coreligionnaires et leurs litanies tristes. Quand rien ne parvenait à faire taire en moi leur désespoir, leurs avertissements, il me restait l’ultime recours du chant. C’est comme ça qu’il a commencé, cet amour-là, pour couvrir leurs voix.
La différence entre Adèle et Louis – et d’ailleurs entre elle et la plupart des gens de notre entourage d’alors - c’était que ma mère avait ses fameux rêves. D’Amérique, de stars, d’un monde lumineux et brillant comme le diamant. Elle se nourrissait de magazines, de romans et de cinéma. Papa, qui ne rêvait pas, regardait ça d’un œil mauvais, l’aurait bien gardée sous cloche, son épouse un peu trop flamboyante pour le quartier. Il n’avait pas tort, du reste, de se méfier. Je crois bien que Maman a eu plus que de l’amitié pour ce soldat yankee qu’elle a revu cinquante ans après la Libération.
Ils avaient en commun les désillusions et la peur, mais Maman se ménageait des sorties de secours, des possibilités d’évasion. Ton grand-père, lui, a toujours vécu confiné. Travailler seul dans sa cave, déjà, n’aide pas vraiment à l’ouverture. Bien sûr ça n’avait pas toujours été le cas. Il avait eu son horlogerie, avant guerre. Mais posséder sa propre affaire n’est pas compatible avec la passion du tiercé. Papa était un parieur impénitent. Toutes leurs économies y sont restées. C’est d’ailleurs en partie la raison pour laquelle Maman a voulu qu’ils quittent Paris. En l’arrachant à ses copains de jeu, elle espérait lui faire passer sa « sale habitude ». Elle y a à peu près réussi, je crois, mais au prix d’un isolement de plus en plus grand à mesure que papa se renfermait, donnait libre cours à sa jalousie et ses rancœurs. Je ne suis pas sûre qu’elle y ait beaucoup gagné.
Cette cave, quelle horreur ! J’en ai encore la chair de poule. J’ai dans les narines son odeur d’humidité dense. J’y revois Papa courbé sur son ouvrage, ses mains, seules, éclairées par une lampe articulée, et lui minuscule et maigre, comme mangé par le noir autour. Il n’y avait rien de pire, pour moi, que d’aller le chercher dans cette antre à la demande de Maman, pour qu’il vienne dîner ou sorte l’argent des courses de son porte-monnaie car c’était lui, malgré sa manie dangereuse, qui tenait, et bien serrés, les cordons de la bourse familiale ainsi que les comptes, sur un petit cahier. En fait, je le revois essentiellement comme ça, courbé sur sa tâche ou sur ses sombres pensées.
Et puis parfois, Dieu sait pourquoi, cette lueur malicieuse que j’avais tant aimée enfant et que j’ai revue à la fin de sa maladie, s’offrait une apparition brève dans ses yeux. Il racontait une histoire savoureuse, avec sa gouaille de titi yid, était soudain tendre, semblait presque heureux, embrassait mon front en m’appelant ma chérie jolie. Mais Maman, ça l’agaçait cette humeur-là. Au nom de je ne sais quelle frustration, quel compte à régler entre eux, elle le tolérait encore moins léger qu’étouffant. Il fallait qu’elle le rabroue. Quelques mots d’elle, et la lueur avait disparu, la tension reprenait le contrôle de ses traits. Il redevenait le père enfermé avec ses ombres.
Extrait de Et qu'on m'emporte, Albin Michel, 2009
Lieu de vie
Île-de-France, 75 - Paris
Types d'interventions
- Ateliers d'écriture en milieu scolaire
- Rencontres et lectures publiques
- Résidences
- Rencontres en milieu scolaire