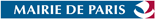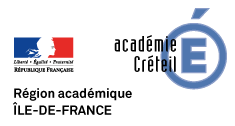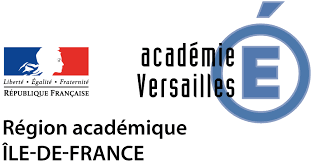Expression libre
Textes
ajouté le 07|04|14
Entretien avec Marie-Christine Bordeaux Maître de conférences, chercheure au Gresec Université Stendhal Grenoble 3 Membre du Haut conseil de l’éducation artistique et culturelle. Réalisé par Sophie Abellan (Mel) avec le concours de Robert Martin (Mel) à l'occasion de la parution de l'ouvrage de Marie-Christine Bordeaux et François Deschamps, Éducation artistique, l'éternel retour ? : une ambition nationale à l'épreuve des territoires (Éditions de l'Attribut, 2013).
Comment vous est venue l’idée de ce livre ? Y a-t-il une adéquation avec le contexte politique, et l’éducation artistique vue comme une grande cause nationale ?
Ce livre est une commande de notre éditeur — les éditions de l’Attribut — qui savait que j’avais travaillé sur cette question et je faisais partie, avec François Deschamps, du collectif « Pour l’éducation par l’art ». Ce collectif a été très mobilisé auprès des pouvoirs publics au moment de la concertation sur la refondation de l’école et de la concertation sur l’éducation artistique. Nous sommes assez peu de chercheurs, en France, à travailler régulièrement, et de manière approfondie, sur ces questions, si bien que la littérature est relativement peu abondante au regard de l’avancée des politiques publiques en France et au regard du nombre de projets réalisés dans toute
Le grand moment de l’éducation artistique, cela a été aussi le plan Lang-Tasca dans les années 2000. On n’est pas beaucoup revenu dessus de manière critique, pour en souligner les apports positifs, que tout le monde reconnaît, mais aussi sur les limites, limites temporelles dans la mise en action, puisque les collectivités locales ont été associées dans un premier temps puis cela s’est arrêté pendant un quinzaine d’années, jusqu’aux grandes lois de décentralisation.
En fait, il y a plusieurs moments fondateurs dans l’histoire de l’éducation artistique. Le premier est 1983, année du protocole d’accord national : il officialise des expérimentations militantes qui se faisaient sans moyens ni validation institutionnelle. C’est donc une date très importante. Un autre moment aurait pu être la loi de 1988 sur les enseignements artistiques, mais il s’agit d’une loi-programme avortée, dont le seul bénéfice est d’avoir cadré des questions très concrètes concernant l’intervention des artistes et des professionnels dans les établissements scolaires et en partenariat avec les équipements culturels. C’est pourquoi le plan Lang-Tasca, en 2000, est le deuxième grand moment de l’éducation artistique, pas seulement à cause de son ampleur, ni à cause de son budget, mais aussi parce que l’éducation artistique était pour la première fois pensée comme une véritable politique globale. Mais ce plan fut affaibli et dénaturé à mi-parcours (il était prévu pour atteindre son plein fonctionnement au bout de cinq ans). Luc Ferry, qui succède à Jack Lang à la tête du ministère de l’Éducation nationale, porte à cet égard une responsabilité importante. Le plan Lang-Tasca n’était pas un dispositif, ni un mode de financement de projet. C’était une vraie politique dans la mesure où il comprenait un dispositif pour financer les projets locaux — les classes à PAC (Projet artistique et culturel) —, et aussi tout ce qui était susceptible de rendre l’éducation artistique durable : des pôles nationaux de ressources qui maintenant sont déclinés en pôles régionaux et qui, selon François Deschamps et moi-même, devraient être généralisés et confiés aux Régions ; l’édition de supports pédagogiques et culturels d’une qualité remarquable, portant sur l’ensemble des domaines artistiques et culturels ; la mise à disposition de tous des textes de référence sur l’éducation artistique, qui sont nombreux ; un site Internet remarquablement doté de ressources, qui a lui aussi cessé d’exister, et a été remplacé par un site interministériel beaucoup moins utile. À cette époque, on peut parler d’une véritable « publicisation » de l’éducation artistique, c'est-à-dire que ce sujet est devenu une question publique. La seule erreur, à ce moment-là, a peut-être été, parce qu’il fallait agir très vite — on sait très bien qu’un gouvernement a deux ans pour agir, et ce que voulaient faire Jack Lang et Catherine Tasca en deux ans était considérable —, de sous-estimer le rôle des collectivités territoriales et de ne pas réellement les associer. Une université d’été a été organisée sur ce thème à Chambéry en 2002 mais n’a pas été véritablement suivie d’effets, alors que les collectivités étaient déjà, depuis les années 1990, dans un mouvement lent mais très sûr d’investissement et d’appropriation de l’éducation artistique. D’ailleurs la loi de refondation de l’école de Vincent Peillon et le grand projet de l’éducation artistique d’Aurélie Filipetti s’inspirent, de près ou de loin, de manière plus ou moins explicite, de deuxième grand moment fondateur. Il faut tout de même se rappeler que cette époque, dont le monde de la culture déplore aujourd'hui la perte – avait fait l’objet de vives critiques. Les classes à PAC étaient considérées par un certain nombre d’acteurs culturels comme une sorte de « SMIC culturel », d’ersatz de dispositifs destiné essentiellement à faire des économies, et dans lequel on ne pourrait pas réaliser le projet de l’éducation artistique, en raison du faible nombre d’heures. On passait en effet des ateliers de pratique artistique, qui comptaient au moins une quarantaine d’heures réalisées en partenariat (ce qui ne préjuge pas du nombre d’heures dans l’exploitation pédagogique sans que le partenaire soit présent), à une unité d’action de huit à quinze heures en partenariat. Mais à l’époque, à peine 4 ou 5 % de la population scolaire avait accès à l’éducation artistique, compte non tenu des chiffres importants d’« École au cinéma », « Collèges au cinéma » et « Lycéens au cinéma ». Pour généraliser, il fallait donc s’appuyer sur des formats plus réduits. Sauf cas exceptionnel, les DRAC ne finançaient donc pas les classes à PAC. Le financement était assuré à moitié par le ministère de l’Éducation, ce qui était une véritable révolution, l’autre moitié devant être recherchée di côté des collectivités territoriales.
Si vous le voulez bien, nous allons revenir maintenant très concrètement sur trois dispositifs qui, chacun, répondent à des questions et des problématiques, que vous soulignez dans votre livre, de mise en place et de coordination, et qui ont un historique révélateur de la marche lente de l’éducation artistique. Le premier, c’est le modèle mis en place par l’association « Les Enfants de cinéma » (« École au cinéma », qui a son pendant au collège et au lycée : « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma », mais qui répondent à des logiques différentes et qui ont beaucoup moins de succès, touchent moins d’élèves, et dont l’organisation pose aujourd’hui problème). « École et cinéma », c’est une coordination nationale, une association à Paris, qui déploie dans chaque département une double coordination locale : une personne de l’Éducation nationale, généralement un conseiller pédagogique, puisque cette action touche le premier degré, et un coordinateur du cinéma, un directeur de salle de cinéma. Les DRAC sont partie prenante de ce dispositif en allouant des financements pour la location des films et la rémunération des coordinateurs Cinéma. Et les collectivités s’investissent également. C’est un modèle qui décline une coordination nationale – ce que vous avez appelé une instance de direction – et une coordination locale avec un partenariat d’organisation, qui permet de développer les projets avec les acteurs locaux.
En fait, le modèle d’ « École au cinéma » s’est développé parallèlement, un peu comme les centres de formations des musiciens intervenants (CFMI) qui formaient – et forment toujours – des professionnels de l’intervention en milieu scolaire, avec un statut hybride, mi-pédagogue, mi-artiste. « École et cinéma » s’est développé avec une logique différente de celle du spectacle vivant, sans véritable confrontation d’idées et de modes opératoires, car le cinéma est à la fois un art et une industrie culturelle. Il n’y a d’ailleurs pas eu beaucoup plus de confrontations d’idées avec le monde du patrimoine et des musées, qui est pourtant un secteur très dynamique en la matière. Dans les DRAC, c’était souvent le conseiller pour le cinéma qui suivait ces dispositifs, de même qu’en administration centrale, où c’était le CNC, qui avait un statut un peu particulier puisque c’était à la fois une organisation distincte du ministère de
Oui, complètement. Il s’agissait d’interroger la pertinence d’un modèle qui il y a vingt ans, pensait déjà l’articulation entre le national et le local et intégrait les collectivités territoriales. C’est vraiment cette articulation que vous mettez en avant comme proposition : le national qui, pour « École et cinéma, est le CNC, l’instance financière, bien sûr, mais aussi de légitimité et de référence, et ensuite une appropriation par les collectivités, avec un cadre, que met en œuvre une association nationale.
Nous avons dans ce cas un dispositif avec un pilotage national fort, à la fois très centralisé et laissant localement dans les régions la possibilité de choisir parmi une palette de films, donc une possibilité d’adaptation locale, c’est efficace et le nombre d’élèves touchés est considérable. Mais ce dispositif peut avoir des inconvénients : par exemple la politique du CNC qui consiste à demander aux départements de développer l’éducation au cinéma sur la totalité de leur territoire, même en l’absence de salles d’art et essai, peut aboutir à un blocage. C’est sans doute une des causes du recul des collèges dans les derniers bilans d’éducation au cinéma. Le financement des transports pour la venue des scolaires représente un budget très important. Il faut souligner que l’éducation au cinéma est ancrée dans l’histoire de l’école, pas d’aussi longue date que les arts plastiques et la musique, évidemment, mais on constate que dès les années 1920 existaient des organisations nationales pour développer cette éducation auprès des jeunes. On voit donc que le cinéma n’est pas quelque chose qui se développe tardivement dans l’école, à l’époque moderne. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les collectivités ont accepté un système que par ailleurs elles récusent : financer un dispositif conçu par l’Etat.
Cela me permet de faire la liaison vers le deuxième dispositif sur lequel je souhaitais qu’on échange, qui répond à une autre proposition que vous faites dans votre livre, c’est que les collectivités deviennent chefs de files et porteurs de projets. C’est ce qu’a développé depuis quatre ans le Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui s’intitule « Missions culture et arts au collège » ou « Art et culture au collège » et consiste à développer des parcours de 40 heures dans chaque collège du département, chacun d’entre eux pouvant mettre en place au maximum trois parcours. Ceux-ci sont mis en place avec des structures culturelles et des artistes, qui les présentent aux établissements, ce qui peut donner lieu parfois à un effet de « catalogue » et de grande sollicitation pour les enseignants, de 40 heures, qui se découpent ainsi : 20 heures de pratique artistique, ce qui est énorme, ce que beaucoup de collectivités, pour des raisons budgétaires, ne peuvent pas mettre en place, 10 heures de temps d’échange et de bilan – c’est assez remarquable d’avoir introduit dès le début dans le dispositif un temps dévolu à l’échange et au bilan entre les différents partenaires – et un temps de sorties scolaires, et de rencontres avec des invités, des artistes intervenants. Donc c’est un département qui s’est vraiment saisi de la question et a développé son propre modèle. Évidemment il y a eu des arguments politiques et sociologiques avancés pour expliquer cette autonomisation du département, qui est le plus jeune et le plus pauvre de France. Il y avait pour les politiques une obligation importante de proposer aux jeunes du département, et aux collèges puisque cela relève de leur responsabilité, un parcours plus que signifiant en matière d’éducation artistique. Et là, on retrouve un département qui s’est saisi, sans attendre ni les financements ni l’aval de l’État, ni le fait que la question de l’éducation artistique soit posée, de la question de la démocratisation culturelle. On a vraiment un esprit de projet, qui est développé avec une notion de parcours pour l’élève extrêmement forte, puisque c’est une articulation entre rencontre avec un créateur, rencontre avec d’autres œuvres avec d’autres porteurs de projets. Et à la fin est envisagée une restitution publique. On retrouve donc la notion de parcours qui était développée il y a une quinzaine d’années. La restitution n’est pas posée comme obligatoire, mais elle découle du nombre d’heures qui est posé, du nombre important des 40 heures. Il est intéressant de voir qu’une collectivité s’est saisi il y a quatre ans d’un projet et l’a développé, et je sais que d’autres collectivités essaient d’appliquer ces « Culture et arts au collège », en se demandant comment le faire, lorsqu’on n’a pas initié d’une façon poétique [politique ?] et personnelle, puisque c’était sur la volonté personnelle des élus de l’époque, pour développer un tel parcours, qui a d’ailleurs son pendant avec des résidences nommées « In situ », qui mettent réellement en valeur la création contemporaine. Donc ce n’est pas seulement un dispositif d’éducation artistique centré sur l’élève, on a également son pendant sur la création d’aujourd’hui, et une mise en valeur très importante des artistes sélectionnés : une dizaine par an. Ils [Elles, les collectivités] ont également joué leur rôle de découvreur de talents artistiques et de présence sur un territoire.
Oui, le cas de
En revanche, les Régions sont inégalement impliquées et, à mon avis, globalement en retard sur ces questions, et ce n’est pas « Lycéens au cinéma » qui suffit à répondre aux besoins dans les lycées et les jeunes en apprentissage. Par ailleurs, nous sommes dans une période de mutations dans les grandes agglomérations, et dans cette conjoncture l’éducation artistique n’est pas un sujet abordé. On ne sait pas ce qu’elle deviendra, telle qu’elle est portée par un certain nombre de grandes villes, à partir du moment où ces dernières deviendront non plus des communautés d’agglomérations, mais des grandes métropoles. Il y a donc une attente vis-à-vis des Régions, et une inquiétude concernant les grandes villes.
Comme on le pensait et le mettait en pratique dès les années 90, les départements apparaissent comme une échelle pertinente pour coordonner et équilibrer l’éducation artistique sur le plan territorial. Dans une étude récente que j’ai faite avec l’Observatoire des politiques culturelles à la demande du Conseil Général de l’Oise, on voit bien que c’est grâce au soutien et à l’accompagnement du département que les collèges ruraux, nous seulement portent des projets d’éducation artistique, mais aussi deviennent de véritables foyers culturels dans leurs territoires. Un peu à l’image des lycées agricoles, dont c’était une des missions. Avec des réalités territoriales, le CG de Seine-Saint-Denis remet lui aussi en lumière la pertinence de l’échelon départemental. Mais pour que les départements deviennent vraiment chefs de file, non pas de l’éducation artistique en général, mais d’une certaine dimension de celle-ci – je pense notamment à l’équilibre entre les territoires communaux et intercommunaux –, il faut qu’ils ne s’en tiennent pas strictement à leur compétence sur les collèges, et qu’ils puissent être en capacité de co-animer, avec les Régions et avec les villes, un parcours qui commence en amont du collège, et se poursuit en aval, au lycée et dans les centres de formation d’apprentis.
L’exemple de
Je voudrais évoquer un point important, rarement soulevé lors de la mise en place de dispositifs territoriaux. Contrairement aux dispositifs d’éducation artistique des années 80 (ateliers, classes culturelles, options), qui reposent sur le partenariat interindividuel entre un enseignant et un artiste, les dispositifs territoriaux privilégient la coordination au niveau des structures culturelles et des établissements scolaires, voire des bassins de formation. Ce n’est pas le cas en Seine-Saint-Denis, mais ni dans d’autres collectivités qui ont su articuler pilotage territorial et esprit de projet, mais j’ai constaté dans les études que j’ai menées que les collectivités peuvent avoir tendance à s’appuyer préférentiellement sur les structures culturelles qui sont dans leurs champs de compétence,, à les « rentabiliser » en quelque sorte. Cela se fait au détriment des équipes artistiques qui sont certes partenaires des projets au niveau des classes, mais pas partenaires au niveau de la construction et de la conception d’ensemble. Et c’est à mon avis un souci. Je pense qu’il faut savoir associer les artistes, au-delà de leurs interventions en classe, parce que les organisateurs ont besoin de leur réflexion et parce qu’ils sont en capacité d’aider à inventer des dispositifs plus créatifs et plus innovants.
Vous faisiez allusion au dispositif de résidence d’artiste « In situ » du Conseil Général de Seine Saint Denis, qui est très intéressant. Il y a quinze jours je participais à Lyon à un colloque sur les résidences d’artistes en milieu scolaire, et j’ai relevé le changement de regard sur ces résidences que nous considérions dans les années 80 comme des dispositifs hors norme, dotés de budgets inhabituels et non généralisables par nature. Que ce soit en Seine-Saint-Denis ou dans la ville de Lyon (qui développe les résidences d’artistes dans les écoles maternelles des quartiers relevant de l’éducation prioritaire), on voit que ces dispositifs peuvent se concevoir à l’intérieur de stratégies territoriales et contribuer à la généralisation de l’éducation artistique.
Ce qui me permet de parler d’un troisième dispositif qui sur d’autres échelles s’est lui-même investi et n’a pas attendu l’État pour mettre en place un dispositif d’éducation artistique, c’est l’opération « Dix mois d’école et d’opéra », mis en œuvre par l’Opéra de Paris. Ici ce n’est plus une collectivité territoriale qui se saisit et s’autonomise par rapport à l’État, mais c’est une structure culturelle, ce qui pose la question des structures culturelles qui doivent, par obligation morale, ou, plus cyniquement, pour une question d’image, développer une programmation d’éducation artistique propre à leur structure originale, et la force de l’Opéra de Paris c’est évidemment la qualité de sa programmation ainsi que sa grande légitimité vis-à-vis de cette action, mais c’est aussi que le fait que ce dispositif soit extrêmement doté financièrement, avec une mise en valeur du mécénat privé. Il ne s’agit pas de revenir sur la pertinence du mécénat dans la culture, mais cela peut poser question au fait qu’en face l’État, les collectivités, le rectorat, n’ont pas cette même assise financière et en moyens humains, puisque trois enseignants détachés s’occupent du dispositif pour mettre en place des actions, et de fait il y a quasiment pour les collectivités et les rectorats un « effet d’aubaine » à ce qu’une structure culturelle leur propose de relayer ces ateliers artistiques et ces parcours. Nous n’avons plus là de collectivité qui développe une innovation mais qui s’appuie sur une structure culturelle qui elle-même, en fonction de sa programmation, déroule un programme d’éducation artistique.
On peut poser deux questions générales à propos de l’opération « Dix mois d’école et d’opéra », qu’on pourrait très utilement comparer avec « Lycéens à l’opéra » en région Rhône-Alpes, très différent dans sa nature et dans ses effets. Mais nous n’aurons pas le temps de faire la comparaison. La première leçon, c’est la capacité de certains grands équipements culturels, grâce aux moyens dont ils disposent et en raison du projet envers les publics dont ils sont porteurs, d’aller assez loin dans les propositions et dans l’action. Il faut éviter le discours simpliste sur la disproportion entre les moyens de l’Opéra de Paris et les dotations de l’Éducation nationale pour les classes à PAC, quelques centaines d’euros , en attendant de savoir comment seront financés les nouveaux parcours culturels en temps scolaire et les activités périscolaires, tous deux inscrits dans la loi de refondation de l’école. L’Opéra de Paris s’inscrit dans une politique très dynamique des maisons d’opéra pour renouveler et rajeunir leur public. C’est un pari qui est passe d’être tenu : les politiques tarifaires ont été revues, et aujourd’hui, un jeune, un chômeur, un lycéen, un étudiant peuvent accéder à l’opéra dans des conditions acceptables sur le plan financier, sous réserve, bien sûr, que ces places à tarif réduit ne soient pas à visibilité réduite. Ce n’est pas le cas dans toutes les maisons d’opéra, et dans l’ensemble, je crois qu’il y a un vrai respect de ce public. Si les jeunes ont droit au meilleur de la culture, ils ont droit aussi à l’opéra. C’est la base de qu’on pourrait appeler un « militantisme institutionnel », différent dans ses moyens du militantisme de petites structures, mais pas nécessairement différent dans l’esprit. On pourrait dire la même chose du Festival d’Aix-en-Provence, qui n’est plus seulement un festival élitiste et difficile d’accès financièrement, grâce à des opérations de sensibilisation, d’éducation, menées en profondeur et dans le temps long des projets. Une question importante, pour ces grandes structures, est de savoir et pouvoir partager leur expérience avec des acteurs qui ne sont pas et ne seront jamais dotés des mêmes moyens. C’est un vrai défi pour les grands établissements publics nationaux.
La deuxième question est celle du niveau pertinent de l’action, question qui a toujours été délicate : pourquoi mettre autant de moyens dans des projets qui concernent seulement certaines classes et des populations qui ne cessent de se renouveler – le milieu scolaire, c’est un peu le tonneau des Danaïdes ! Ne pourrait-on pas diffuser davantage ces moyens ? Certes, la généralisation est un nouvel impératif depuis les années 2000, mais il ne faut pas sous-estimer le besoin de projets-phares, de projets que l’on prend le temps d’expérimenter, de boîtes à outils et de réservoir à idées. Que serait l’éducation au théâtre, par exemple, s’il n’y avait pas eu les ateliers et les options théâtre, qui sont aujourd'hui critiquées pour leur coût ? Si on supprime les ateliers, options artistiques, et s’il n’y a plus que les parcours culturels inscrits dans la loi, il suffira de modifier la loi pour détruire toute la base institutionnelle de l’éducation artistique. Celle-ci ne doit pas être pensée « à plusieurs vitesses », mais doit pouvoir se développer selon des temps différents et des dispositifs différents. Cette variété des formes d’accès à la culture est essentielle. Si les projets-phares masquent un néant de propositions pour le jeune public, le public étudiant, les personnes considérées comme éloigné de la culture, ce sont des projets-alibis. L’enjeu est de les situer dans un continuum, de responsabiliser les enseignants, de créer des espaces où vont se ressourcer les acteurs, dans leurs pratiques pédagogiques ou artistiques, et de les organiser de telle sorte qu’ils pourront ensuite développer localement leurs projets. Cela s’appelle un pôle de ressources, selon la terminologie du Plan Lang-Tasca, qui a beaucoup innové dans ce domaine. Bien avant ce plan, une grande partie des enseignants militants de l’éducation artistique s’était formée dans les stages de réalisation Jeunesse et Sports et dans les stages des fédérations d’éducation populaire. Ils se trouvaient alors dans des conditions de production qu’ils ne retrouveraient jamais ensuite dans leurs classes. Pour autant, ces formations ont été efficaces pour diffuser plus largement les pratiques artistiques et l’intérêt pour les activités culturelles. Il faut donc poser, au-delà des effets directs sur les enfants et les jeunes, la question de la responsabilisation des enseignants et de leur formation. Question qui a été très malmenées ces dernières années, et qui est à résoudre dans la réforme de la formation des enseignants.
Au-delà de l’engouement pour les TICe et la culture numérique, il serait utile de revenir à ce que disait Augustin Girard il y a fort longtemps, et pour quoi il avait été très critiqué : on sous-estime le rôle des industries culturelles dans le développement de la démocratisation culturelle. On peut aujourd’hui assister en direct à des représentations d’opéra et de danse dans certains réseaux de cinéma. Pourquoi ces représentations ne seraient-elles pas accompagnées de rencontres avec des artistes, d’ateliers de réalisation, en lien avec des structures locales, et bien sûr sans négliger le rapport vivant à la scène, qui reste essentiel et accessible dans de nombreux territoires ? Le cas du cinéma, dont nous parlions tout à l’heure, montre qu’il y a des dimensions à penser ensemble, entre les domaines qui relèvent plutôt des industries culturelles et ceux qui relèvent plutôt de l’artisanat du spectacle vivant. Il faudra être attentif à ce qui se passe, par exemple, du côté de
Nous allons maintenant nous intéresser à un dispositif d’éducation artistique que conduit
Il est vrai que la littérature, comme la musique et les arts plastiques, sont des domaines à part. Car ce sont des disciplines scolaires, et elles correspondent à des programmes. Au-delà du fait bien connu que l’école a toujours un temps de retard sur la société, la culture de l’école prend le temps de faire le tri entre ce que produit au quotidien toute société et ce qui restera comme patrimoine littéraire et artistique. Ce décalage est donc consubstantiel à l’école, et n’est pas en soi négatif. Mais grâce au développement sans précédent du champ professionnel de la culture, nous pouvons aujourd’hui mettre en contact avec la création contemporaine des jeunes qui la découvriront au moment de son émergence et non après coup, au moment de son institutionnalisation. C’est une voie privilégiée pour apprendre à penser par soi-même. Songeons que certains auteurs, aujourd’hui considérés comme des références, n’ont pas été accessibles sous prétexte qu’ils n’en n’étaient qu’à leur premier livre. Or, ce qui fait la durée d’une œuvre, ce n’est pas seulement son institutionnalisation par le biais de son inscription dans le champs de la littérature consacrée (bien que cette dimension ne soit pas négligeable), c’est sa capacité à nourrir l’imaginaire, à nous interroger, à faire de nous des lecteurs, c’est-à-dire des personnes engagées dans une expérience culturelle et esthétique. L’œuvre survit tant qu’elle reste en capacité de nous aider à nous instaurer nous-mêmes comme lecteurs.
Dans le cas de la littérature, il y a une telle fusion de l’œuvre littéraire dans l’enseignement du français et de la littérature que le fait de faire venir un auteur en classe est encore assez rare, malgré les efforts des manifestations littéraires et des structures telles que
C’est presque devenu une posture…
Cela peut en effet devenir une posture. Il y peut y avoir une reconstitution a posteriori du parcours biographique, qui insiste sur la souffrance subie à l’école, sur les échecs, sur l’incompatibilité avec la logique scolaire. Dans cette posture « artiste », la liberté, imaginaire, l’innovation sont du côté de l’art, et la vision de l’école est assez archaïque. Lorsque le dialogue se durcit, il arrive que l’on entendre des questions telles que « pourquoi dois-je venir, moi, auteur ou artiste, pour remettre du plaisir dans la classe ? N’êtes-vous pas capable vous-même de donner du plaisir, de rendre les savoirs désirables? » Le discours de la rédemption par l’art, même s’il correspond à des expériences vécues, ne peut pas être le discours justificatif de l’éducation artistique car il ne repose pas sur une vision juste de ce que peuvent faire les créateurs et de ce qu’il faut attendre des enseignants. Pour moi, ce qui doit justifier l’éducation artistique, c’est la question des droits culturels. Elle permet, par le biais de l’école qui s’adresse à tous, la mise en œuvre d’un droit constitutionnel, le droit à la culture. L’ambition autrefois portée par l’éducation populaire, serait de concevoir cela pour tous les âges de la vie, mais aujourd'hui, l’urgence est de le réaliser concrètement dans l’école. L’accès à la culture est une formule large, qui a pu être interprétée de manière étroite. Il s’agit de la culture dans son ensemble: la culture instituée, la culture du temps présent, et la culture de chacun dans la mesure où elle est inscrite dans un dialogue avec d’autres cultures. Dans tous les cas, il s’agit de ne pas être le relais de la « misère symbolique » qui peut caractériser les productions issues de processus industriels, et de garantir l’accès à des œuvres fortes et à des processus qui permettent de construire du sens. C’est pourquoi le partenariat a toujours été un élément-clé de l’éducation artistique, car il conduit chacun à travailler, non aux objectifs de l’autre, bien entendu, mais à mieux réaliser ses propres objectifs dans le cadre d’un projet partagé.
D’ailleurs, le rôle de L’Ami littéraire n’est pas tant de pallier à tel ou tel manque que d’offrir un cadre qui facilite le projet en matière d’organisation, de rémunération, de suggestion d’auteurs également, puisque cela permet de faire découvrir à des enseignants un créateur, ou de les inciter à le recevoir en faisant des suggestions pertinentes selon un large champ de critères. C’est un partenariat à la fois instituant, puisqu’on dépend du Centre national du livre, mais aussi un partenariat facilitateur pour provoquer cette rencontre. Et d’ailleurs bien avant la rencontre – nous demandons qu’elle soit préparée – l’enseignant et l’auteur sont mis en contact. Il y a bien auparavant un dialogue, souvent par courriel, entre les deux, et lorsque c’est possible, une réunion préparatoire, pour que chacun s’entende, au sens plein du terme, sur le projet à développer.
Je pense que cela ne peut marcher que si l’enseignant est reconnu comme un acteur culturel du projet, mais bien sûr pas en concurrence avec l’auteur. Pour réussir, le projet s’appuie sur des compétences, des métiers et des talents différenciés. Le rôle de l’enseignant ne se borne pas à chercher des moyens d’illustrer le programme, de tenir la classe tranquille, de préparer la venue de l’écrivain. Dans L’Ami littéraire, avec Le Temps des écrivains, l’enseignant est coproducteur d’un projet qui est à la fois pédagogique et culturel. D’une certaine manière, la venue d’un artiste ou d’un auteur réveille cette fonction culturelle de l’enseignant et ne s’y substitue pas/ En sociologie de la culture, lorsqu’on demande au cours des questionnaires ou des entretiens par qui le goût pour la culture a été éveillé, très souvent les enquêtés citent un enseignant. Et il n’est pas rare que ce soit un professeur de lettres.
C’est vrai, et dans les bilans des rencontres organisées, pour les enseignants, un des signes de succès, c’est le fait qu’ils ont eu très peu à intervenir pendant l’échange, parce que les élèves ont été bien préparés, ont des choses à dire et à exprimer, et deviennent vraiment acteurs, à la fois dans l’instant et déjà en situation d’interpréter, d’établir des relations, des plans, de poser des questions littéraires et para littéraires. Pour le professeur, le signe que la rencontre s’est bien passée, c’est quand ils ont pu rester au fond de la classe, quand la chose, presque, leur échappe…
Et ils ont seulement la fonction de cadrer la rencontre, de revivifier le d&eac