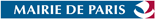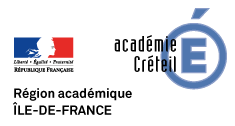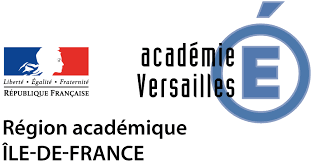Expression libre
Textes
Jean-Claude Pinson
écrivain
ajouté le 07|02|17
Frères oiseaux
« Par une matinée de printemps, Amelius, philosophe solitaire, se tenait entouré de ses livres, à l'ombre de sa maison de campagne, et lisait. Touché du chant des oiseaux qui volaient à l'entour, il se mit à les écouter et à méditer, puis abandonna sa lecture. Enfin, il prit sa plume et, sur place, écrivit ce qui suit. »
Ainsi commence l’Eloge des oiseaux de Leopardi.
Composé en 1824, c’est un essai très court. Une dizaine de pages, pas plus, figurant dans le volume des Operette morali, les Petites œuvres morales du poète italien. Une prose de caractère réflexif, philosophique. De la métaphysique, mais pas du tout absconse. Une pensée claire comme le jour, aérienne, poussant très loin son investigation pour mieux saisir les plus fines nervures du sensible. Un éloge, un hymne, mais nulle emphase. Une prose pleine de fraîcheur et d’élan, donnant des ailes au lecteur, l’invitant à lever les yeux d’entre ses lignes, pour écouter, regarder, rêver, méditer. Et bientôt jeter lui-même quelques notes sur les pages de garde qui attendent ses remarques à la fin du volume. Ce que j’ai fait, écrivant sur le motif ce qui suit.
*
Le motif, l’endroit ? Non loin de Tharon-Plage, un hamac à l’abri d’une dune, tandis qu’un vent de suroît fait chanter les cimiers des grands pins qui la peuplent. C’est là qu’un matin de mai, imitant Amelius, à l’ombre d’un acacia et au creux d’un hamac, j’ai lu – relu plutôt – le petit essai de Leopardi.
Beau temps, grande lessive très haut dans le ciel, chassant les nuages. Vue imprenable sur le bleu du ciel, artistement découpé par le feuillage tendre de l’acacia. Avec pour bande-son, en guise de basse continue, la grande rumeur de la mer, sa psalmodie toujours recommencée, tandis qu’au loin, houpoupoup, parvient feutré l’appel d’une huppe, muezzin du matin lançant à intervalles réguliers son triolet prosélyte (à l’aube, avec l’accord des merles, elle avait ouvert la conférence quotidienne des oiseaux).
*
Lire en plein air est un plaisir singulier – un plaisir stéréoscopique, contrapuntique. Car double est l’oraison. Il y a celle, toute intérieure et silencieuse, qui nous fait mentalement habiter l’espace du livre. Mais celle aussi, extérieure, peuplée de bruits et sons divers, qui nous ouvre au Grand Tout du monde, à son mouvement.
On est dans le livre, on suit sa courbe, narrative ou pensive, on feuillette, on s’enfonce dans les sentiers qui serpentent entre ses pages. Et en même temps on est dehors, participant à la respiration du paysage, frémissant au vent avec les feuillages, humant les fragrances qui passent fugaces dans les airs, du regard un instant suivant la lente transhumance, très haut, d’un troupeau maigre de nuages. Et lorsque le sujet du livre, son motif, correspond au lieu où l’on en fait lecture – lorsque c’est sur le motif qu’on lit un livre qui parle de ce même motif, comme c’était le cas de cette mienne relecture « pleinairiste » de l’Eloge des oiseaux, alors paysage intérieur et paysage extérieur se recouvrent presque.
On lit le mot « ciel », on rêve d’y planer, et en même temps, à la faveur de ce « contre-plongeon » que permet le hamac, on baigne dans ces lacs de grand bleu entrevus béants à travers le treillis du feuillage. On imagine les oiseaux dont parle le livre, et en même temps on les voit « pour de vrai ». On suit du regard, tout là haut égaillées, un grand semis de mouettes planant à l’étage supérieur. Chacune de son propre tracé s’enivrant, lentement, voluptueusement, sur la glace bleue du ciel dérivant, holiday on sky. Tandis que plus bas, toujours en mouvement, tire sans fin des bords l’armada piaillante de plus petits voiliers, mésanges et bruants zizis (si, si, ce sont bien eux, petits zozios en livrée jaune et rousse). À mi-hauteur, aux étages intermédiaires, vaquent les tourterelles et parfois passe, d’un vol furtif et ondulant, à la sauvette, un geai zébrant de bleu, rapide signature de bateau ivre, le vert touffu des feuilles.
*
Lire, c’est aussi toujours peu ou prou s’identifier aux héros dont le livre qu’on lit chante les louanges. « Je voudrais un moment me transformer en oiseau pour connaître le contentement et la joie qu’ils éprouvent à vivre », écrit Leopardi. Mais pouvons-nous vraiment partager, comme semble nous y inviter le poète, ce que les oiseaux ont en propre, à savoir la combinaison du vol et du chant ? Savons-nous ce que voit, en plongée, un oiseau planant haut dans le ciel ? Tout autre chose sûrement que ce qu’on peut apercevoir depuis le hublot d’un avion.
Le langage, la conscience, le savoir que nous avons de notre mortalité, la mélancolie qui l’accompagne, tout cela fait de nous une espèce un peu à part, « les plus malheureux des animaux », « écœurés de la vie », écrit même Leopardi. Il est vrai que nous n’applaudissons pas tous les jours, comme le font les oiseaux, à l’existence universelle (à supposer, ce dont on peut douter, qu’ils le fassent). Allegrezza, l’allégresse, n’est pas notre pain quotidien. Mais de les voir et de les entendre, voilà qui presque suffirait à nous faire devenir leurs semblables, leurs frères. Car leur joie, qui est « chose publique », est communicative, enivrante. Nous les voyons voler et c’est nous-mêmes qui nous envolons, soudain reconnectés au grand mouvement de la vie. Nous les entendons chanter, et l’envie nous prend à notre tour de vocaliser.
Et c’est ainsi que du fond de votre hamac, vous vous surprenez à fredonner un air de Scarlatti ou à reprendre ce vieux refrain de Mouloudji proclamant que « Faut vivre, faut vivre ». Même si la toile épaisse d’un hamac n’est pas la voile soyeuse d’un parapente ou d’un parachute, c’est bien un sentiment d’allégresse, d’arrachement à la pesanteur terrestre, que vous éprouvez. Votre lecture stéréoscopique devient comme un vol immobile et soudain vous vous sentez appartenir mieux que jamais à ce que Leopardi nomme la « vie universelle » (vita universale).
*
Cette fraternité avec les oiseaux, pour l’auteur du Zibaldone, n’est pas à sens unique. Si nous sommes, comme eux, capables de joie et de chant (voire de vol), en retour, eux sont comme nous capables de rire. L’idée paraît au premier abord étrange. Elle l’est un peu moins quand au ciel s’égosille une escadrille de mouettes qu’évidemment on ne manque pas d’imaginer riantes autant que rieuses.
Disons que Leopardi fait du rire un attribut obligé de la joie qu’il prête aux oiseaux. Il le pense comme une façon, contre-mélancolique, de prendre la vie toujours du bon côté, quoi qu’il en soit ; comme une façon de se mettre en état de douce folie et légère ébriété, afin de pouvoir ressentir sa propre présence au monde comme enfantine participation à ce grand jeu qu’est, selon Héraclite, la marche n’allant nulle part de l’univers, son « éternullité ».
Et si joie continuelle et rire des oiseaux il y a, c’est qu’il leur est donné, mieux qu’à nous, de jouir de la beauté des spectacles qu’ils peuvent, eux, depuis le ciel contempler. Aussi ont-ils une âme d’esthètes. Ce sont des amoureux du beau, comme nous sensibles à l’agrément des lieux, aimant les beaux paysages, y compris et surtout, précise Leopardi, ceux qui sont le fruit du travail humain, les paysages artificiels.
Les oiseaux, nos semblables, nos frères.
Il leur prête encore, notre poète, la faculté d’imaginer. Non pas celle, profonde, orageuse, lestée d’angoisse et de pensées funestes, qui fut, dit-il, le lot douloureux de Dante ou du Tasse. Non, une imagination légère, enfantine, variée. Ils ne sont pas seulement riches de cette vie extérieure dont témoigne leur incessant mouvement – le fait qu’ils ne peuvent, pas plus que les enfants, tenir en place. Ils sont riches aussi d’une « vie intérieure ».
Mais que peut bien-être, des oiseaux, le for intérieur ? Et s’il en est un, de quoi peut-il bien être peuplé ? Nous n’en savons évidemment pas grand’chose. Cependant, ils ont un cerveau et le matérialiste convaincu qu’est Leopardi imagine, puisqu’ils volent et sans cesse sont en mouvement, puisqu’ils migrent d’un continent à l’autre, qu’ils ne peuvent qu’avoir la vie intérieure la plus mobile. Et puisqu’ils voient, en volant, tant d’images variées, tant de spectacles immenses et changeants ; puisqu’ils lisent, à livre très ouvert et cœur perdu, la très grande partition de la Nature, ils ne peuvent au fond qu’avoir une âme de poète, visionnaire, riche en ces affects de toutes sortes dont témoignent leurs chants.
*
Votre lecture s’achève. Vous acquiescez, vous vous laissez dériver heureux dans le sillage des derniers mots du livre. Vaguement vous méditez celui de « joie » (letizia) et l’idée qui va avec d’une vie extérieure toute en mouvements et voyages, doublée d’une vie intérieure toute en visions joyeuses et affects heureux.
Vous rêvez, le livre finit par vous tomber des mains et vous-même par tomber dans un demi-sommeil. Une voile de kitesurf rouge et or un instant apparaît au-dessus de l’iconostase végétale que peint en haut de la dune, sur la toile bleue du ciel, la frise des pins et des cyprès. Derrière, invisible, c’est le sanctuaire de la mer. Somnolant, vous avez des visions. Pour un peu vous seriez prêt à croire avoir vu passer, volant à l’horizontale comme dans un tableau de Chagall, un revenant en habit chamarré de pope. Vous êtes même tenté de vous dire, pour rire, que c’est Leopardi se stesso – Leopardi en personne. Il ne désapprouverait pas.
Vous émergez, on approche de midi, le soleil tape de plus en plus fort. Vous pourriez vous croire en Afrique. Car un étrange oiseau bariolé s’est posé sans crier gare sur la pelouse. Costume très chamarré lui aussi (col orangé, robe rayée noir et blanc, crête à plumes déployées en éventail) et royal port de tête emmanchée d’un long bec, vous l’avez reconnue, l’african queen super sapée n’est autre qu’une huppe. Un oiseau que Gracq qualifie de « semi-exotique ». On ne saurait mieux dire, en septembre, elle s’en ira passer six mois de soleil et de joie au sud du Sahara.
Post-scriptum.
Une lectrice attentive autant que perspicace, Christine Lemaire, me fait remarquer que les oiseaux sont aussi, très souvent, « charognards et salopards », « au moins les mouettes, les goélands de tous âges et plumages, jeunes tachetés couineurs et quémandeurs, adultes prêts à en découdre au rivage pour une coquille vide, éventreurs de sacs de touristes négligents… ». Et elle ajoute : « appel de détresse, litiges, cris d’agression et d’intimidation semblent au moins autant que la joie motiver l’usage de la voix des oiseaux ».
Comment ne pas lui donner raison ? La vision que donne Leopardi du monde des oiseaux est exagérément idyllique, en effet. Mais l’auteur du Zibaldone n’est pas ornithologue. C’est en philologue et philosophe qu’il écrit son Eloge.
Philologue, il sacrifie au canon d’un genre où l’enthousiasme est de mise. Non sans toutefois que l’accent lyrique de son poème en prose ne soit discrètement contaminé par la touche ironique qui prévaut dans l’ensemble des Petites œuvres morales. En l’occurrence, et ce n’est pas indifférent, le modèle est ici Lucien et son Eloge de la mouche.
Philosophe, il fait parler un confrère néo-platonicien nommé Amelius, dont on ne sait à peu près rien, ce qui facilite la prosopopée. On l’imaginera naïf, mais d’une naïveté seconde, conquise de haute lutte, après avoir fait l’épreuve du regard ravageur de la philosophie critique. Car celle-ci, pour Leopardi, est finalement nocive en ce qu’elle aboutit à enlever à l’existence ce qui en fait le prix et la saveur. Elle doit donc être dépassée, devenir cette « ultra-philosophie » qui seule est capable de comprendre le mouvement de la pulsion vitale pour l’enrichir et le guider plutôt que le censurer.
L’oiseau léopardien est bien une projection anthropomorphique et son éloge un portrait de l’être philosophique – « ultraphilosophique » – que l’auteur aimerait bien être. Mais cet être idéal, cet ange parfaitement accordé à l’archi-mouvement de la Nature, mène son existence de bête bienheureuse dans un ciel vidé de toute transcendance. Il est pur mouvement, pure action joyeuse désencombrée des affres de la pensée soucieuse. Si anthropomorphisme il y a, on est loin de l’anthropocentrisme habituel. Car ce n’est pas l’homme qui est au centre de l’Univers. Ce n’est pas lui qui est au sommet de la Création. C’est l’oiseau – un oiseau qui certes n’est qu’une fiction philosophique, mais bien utile pour penser les contours d’une existence à contre-courant d’un dolorisme chrétien dont Leopardi a voulu desserrer la trop puissante emprise.
Ce texte a été commandé par la Mel à Jean-Claude Pinson dans le cadre de l’opération nationale « Partir en livre » menée par le Centre national du livre, l’été 2016.